|
De la langue d'oïl au parler acadien
Tiré de Louise Péronnet.
Le parler acadien du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Éléments
grammaticaux et lexicaux. New York, Peter Lang, séries
6, vol. 8, 1989, p.13, 15-16.
Cette étude vise à démontrer
le rattachement du parler [acadien traditionnel du Sud-Est du Nouveau-Brunswick] aux parlers français
d'oïl, d'origine gallo-romane. En effet, même si le parler
acadien s'est développé de façon isolée
pendant plusieurs siècles, à la fois loin du Québec
et loin de la France, il reste malgré tout très proche
des parlers français dont il tire ses origines, en particulier
ceux du Centre-Ouest de la France.
[....]
Au plan phonétique, le parler décrit
s'écarte du FS [français standard] à plusieurs points de vue. Il possède
des variantes qui lui sont propres : les affriquées [tj]
et [d ], variantes
combinatoires, soit de /kl et /g/ qui se palatalisent devant
une voyelle antérieure, soit des groupes /ti/ et /di/ qui se
palatalisent devant une autre voyelle (même devant /a/ et
/ ], variantes
combinatoires, soit de /kl et /g/ qui se palatalisent devant
une voyelle antérieure, soit des groupes /ti/ et /di/ qui se
palatalisent devant une autre voyelle (même devant /a/ et
/ /, par exemple dans ([d /, par exemple dans ([d  b]
diable et [d b]
diable et [d am am ]
diamant). Ces affriquées sont typiques du parler acadien
traditionnel ; on les rencontre surtout chez les Acadiens de la
génération âgée : /k/ devient [tj] dans
[tji] qui, [tjø] queue,[tjyl ]
diamant). Ces affriquées sont typiques du parler acadien
traditionnel ; on les rencontre surtout chez les Acadiens de la
génération âgée : /k/ devient [tj] dans
[tji] qui, [tjø] queue,[tjyl t]
culottes ; /ti/ devient aussi [tj] dans [tj t]
culottes ; /ti/ devient aussi [tj] dans [tj d]
tiendre (tenir), [tj d]
tiendre (tenir), [tj d]
tiède ; /g/ devient [d d]
tiède ; /g/ devient [d ]
dans
[d ]
dans
[d  l]
gueule, [d l]
gueule, [d  p]
guêpe, [d p]
guêpe, [d  r]
guerre ; /di/ devient aussi [d r]
guerre ; /di/ devient aussi [d ]
dans [d ]
dans [d  ]
Dieu, [d ]
Dieu, [d ab]
diable, etc. Ces variantes n'apparaissent pas uniquement à
l'initiale de mots. On les rencontre ailleurs, dans [pitje] pitié,
[akad ab]
diable, etc. Ces variantes n'apparaissent pas uniquement à
l'initiale de mots. On les rencontre ailleurs, dans [pitje] pitié,
[akad  ]
acadien, etc. ]
acadien, etc.
Du point de vue des caractéristiques
phonétiques générales, le parler acadien manifeste
des différences assez importantes avec le FS si on part des traits
suivants, décrits par Delattre (1966) comme étant propres
au français, à savoir le mode tendu, le mode antérieur
et le mode croissant. Dans le parler acadien, le mode n'est pas toujours
tendu ; par exemple, les voyelles /i/, lyl et /u/ sont
réalisées avec un timbre relâché et moins
fermé qu'en FS, sous l'influence d'une consonne forte qui suit,
par exemple dans [vit] vite, [polis] police, [b t]
butte,
[k t]
butte,
[k d] coudre. Quant au second
trait important du français, le mode antérieur, il n'est
pas aussi caractéristique du parler acadien à cause principalement
de la fréquence élevée des [ d] coudre. Quant au second
trait important du français, le mode antérieur, il n'est
pas aussi caractéristique du parler acadien à cause principalement
de la fréquence élevée des [ ]
postérieurs dans ce parler. Enfin, le mode croissant, qui favorise
d'une part la détente des consonnes finales et qui empêche
d'autre part la diffusion de la nasalité, n'est pas, lui non
plus, caractéristique du parler acadien. En effet, les consonnes
finales se réalisent souvent sans détente de sorte que
les occlusives sont généralement implosives plutôt
que explosives en finales absolues, c'est-a-dire que la bouche
ne s'ouvre pas toujours après l'occlusive. Ce trait phonétique
expliquerait la très faible occurrence des groupes finals occlusive
+ consonne dans le parler décrit. Ceux-ci sont presque
toujours réduits à une seule consonne, par exemple dans
/buk/ boucle, [ ]
postérieurs dans ce parler. Enfin, le mode croissant, qui favorise
d'une part la détente des consonnes finales et qui empêche
d'autre part la diffusion de la nasalité, n'est pas, lui non
plus, caractéristique du parler acadien. En effet, les consonnes
finales se réalisent souvent sans détente de sorte que
les occlusives sont généralement implosives plutôt
que explosives en finales absolues, c'est-a-dire que la bouche
ne s'ouvre pas toujours après l'occlusive. Ce trait phonétique
expliquerait la très faible occurrence des groupes finals occlusive
+ consonne dans le parler décrit. Ceux-ci sont presque
toujours réduits à une seule consonne, par exemple dans
/buk/ boucle, [ g] aigle,
/fab/ fable, etc. Pour ce qui est de la diffusion de la nasalité,
citons les exemples [ g] aigle,
/fab/ fable, etc. Pour ce qui est de la diffusion de la nasalité,
citons les exemples [  :n]
Jeanne, [ :n]
Jeanne, [ :ne] année, :ne] année,
[fl :m] flamme. :m] flamme.
La plupart de ces traits phonétiques
sont des survivances du français d'autrefois (16e
siècle surtout) et se retrouvent aujourd'hui, soit en français
populaire, soit en francais régional de l'ouest, notamment celui
du Centre-Ouest.
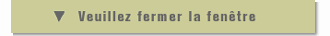
|