|
Québec
1928
Débuts du cinéma parlant
Liens
Le 1er janvier 1906, Ernest Ouimet ouvre la première salle de cinéma à Montréal, le « Ouimetoscope ». Montréal tombe dès lors sous le charme du septième art, encore muet. Mais c’est grâce à l’arrivée du cinéma parlant, en 1928, que cet art connaîtra une expansion phénoménale partout au Québec. Dès 1931, plus de la moitié des salles de la province projettent des films parlants.
Cette nouvelle dimension du cinéma accroîtra la popularité des productions françaises sur les écrans du Québec. Plusieurs sociétés se spécialiseront dans la distribution de films français, au premier chef la Compagnie cinématographique canadienne et France-Film.
À Montréal, le Théâtre Saint-Denis devient à partir de 1930 le haut lieu du cinéma d’expression française. En 1934, plus de 70 000 personnes viendront y voir Maria Chapdelaine. Les dirigeants de France-Film voient dans la découverte des « vues françaises », de leurs réalisateurs, de leurs vedettes et de leur langue un important outil de promotion de la cause nationale.
De 1940 à 1945, la guerre et l'occupation de la France entravent la venue des films français. Plus de la moitié des salles où étaient habituellement projetés des films d’outre-mer ferment leurs portes ou se reconvertissent au cinéma américain, qui connaît un regain de popularité. Parallèlement, l’industrie du doublage se développe. À une époque où le cinéma connaît une très grande popularité, la difficulté d’obtenir des films français favorisera la production locale. Parmi les nombreux titres qui sortent à l’époque, mentionnons Le Père Chopin, de Fédor Ozep (1944).
Le retour de la paix, l’urbanisation croissante et la hausse du niveau de vie, voilà autant de facteurs qui contribueront à l’essor grandissant du cinéma, qui se fait principalement sentir à l’extérieur des deux grandes villes que sont Montréal et Québec. De 1945 à 1952, le nombre d’entrées passe de 44 millions à 59 millions ; les Québécois vont au cinéma une fois par mois en moyenne voir des films américains et français dans une proportion à peu près égale.
Pendant cette même période, le Québec produit lui-même une quinzaine de longs métrages de fiction. Renaissance Films, entreprise dirigée par J.-A. de Sève, s'associe aux milieux cléricaux pour faire de Montréal « un centre mondial de saine cinématographie ». Une autre société, Québec-Productions, dirigée par Paul L'Anglais, met au point une formule à succès qui sera souvent reprise par la suite : adapter au cinéma des œuvres jouissant déjà d'une grande popularité. C’est ainsi que les radioromans Un homme et son péché, Le curé de village et Séraphin seront portés au grand écran à la fin des années 40. D'autres producteurs s’engagent dans la même voie en adaptant pour le cinéma des pièces comme La petite Aurore, l'enfant martyre (1951) et Tit-Coq (1952), qui reçoivent l'un et l'autre un accueil quasi triomphal.
L'arrivée de la télévision, qui se répand très rapidement, porte un dur coup au cinéma. En quelques années à peine, le public se met à déserter les salles, et une centaine d’établissements ferment leurs portes. En 1984, le nombre d'entrées est de quatorze millions. La production locale disparaît : entre 1953 et 1963, aucun long métrage n'est tourné au Québec.
Ce n’est qu’à la fin des années 60 que le milieu s’ajuste à la présence de la télévision. Les distributeurs ferment alors les salles de quartier et en ouvrent de nouvelles dans les centres-villes et les centres commerciaux de banlieue, où l’on présente plusieurs films simultanément pour des auditoires réduits. La programmation cinématographique aussi se transforme et se distingue de celle de la télévision ; les films de répertoire, qui ont la faveur d'un public d'amateurs de plus en plus nombreux et avertis, occupent une place grandissante. Par contre, la quasi-totalité des productions proviennent de l'étranger, dont plus du tiers des États-Unis, et la présence du français diminue.
Mais peu à peu, grâce au soutien de l'État, la production québécoise commence à se réorganiser. Le renouveau vient d'abord de l'Office national du film (ONF), où les réalisateurs francophones, rassemblés en 1964 dans une section autonome, ravivent le documentaire par le recours au cinéma « direct », à saveur sociale et politique. Le film le plus marquant de cette ère nouvelle est réalisé par Pierre Perrault et Michel Brault en 1963 : Pour la suite du monde. Cette production ouvre la voie à une nouvelle cinématographie québécoise et annonce son heure de gloire. Entre 1968 et 1973, plus de 120 longs métrages voient le jour, dont plusieurs obtiennent un succès appréciable, comme Deux Femmes en or de Claude Fournier (1970), Mon oncle Antoine de Claude Jutra (1971), Les Colombes de Jean-Claude Lord (1972), ou La Vraie Nature de Bernadette de Gilles Carle (1972). Si graduellement l'entreprise privée s'y intéresse, la production québécoise de l’époque bénéficie toujours d’un soutien important de l'ONF, et plus généralement des gouvernements fédéral et provincial.
Le cinéma d’auteur commence à battre de l’aile au cours des années 70. Le gros de la production québécoise vise un public beaucoup plus large et moins exigeant, et plusieurs films se feront en coproduction internationale.
Claude Jutras (1930-1986) (Québec)
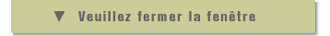
|