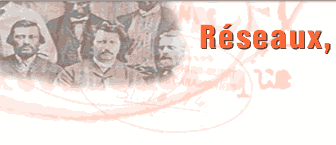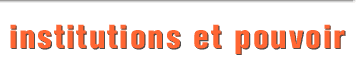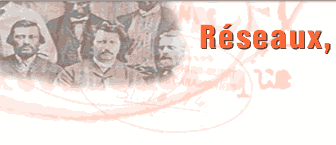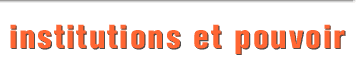|



|
 |
|
À la base des sociétés, on trouve des réseaux qui
lient les individus dans un tissu de relations complexes. Ces réseaux
assurent la communication et la mobilité. Ils permettent aux individus
de s'adapter aux situations qu'ils rencontrent, et c'est souvent par eux que
le pouvoir s'obtient et se conserve.
L'entrecroisement des réseaux forme une charpente sur laquelle se
construit l'identité culturelle. La famille, la parenté, le
voisinage, l'Église catholique, les associations, les coopératives,
les journaux, la radio, la télévision et l'école ont joué
un grand rôle dans la genèse et l'évolution de l'Ouest
francophone, tant pour les Métis que les Canadiens français ou
les Franco-Européens.
Au temps de la colonisation, la famille constituait l'unité sociale de
base : unité de production, elle était aussi le groupe à
partir duquel les loisirs et l’entraide s’organisaient. Mais la famille, ce n'est
pas que le père, la mère et les frères et soeurs ; ce sont
également les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. En fait,
beaucoup de communautés francophones de l’Ouest et du Nord-Ouest se sont
bâties sur les réseaux de parenté.
|
|
|
|
Dans tous les cas, la parenté représente un pôle vital de
la vie communautaire. On se retrouvait après la messe, le dimanche ou pour
des soirées, notamment pendant le temps des fêtes de Noël et du
Jour de l'An. On jouait de la musique, on dansait, et de véritables dynasties
familiales de musiciens se sont ainsi formées. Ces rencontres étaient
d’ailleurs pour les jeunes gens la principale occasion de se fréquenter et
de trouver leur futur conjoint. Même dans l’éloignement, la famille
et la parenté jouent leur rôle de soutien et on y fait appel en cas
de besoin.
|
|
|
|
À la sociabilité familiale s'ajoute la sociabilité
ethnoculturelle et linguistique. Les Français, dès leur arrivée,
formèrent des réseaux d'entraide ; les Belges et les Suisses
développèrent entre eux des solidarités fondées sur
la langue française et l'appartenance européenne. Chez les
Métis, le principal événement rassembleur était
la fête de Saint-Joseph, alors que chez les Canadiens français,
c’était la Saint-Jean-Baptiste. Bazars paroissiaux, parties de cartes,
pique-niques, foires et banquets constituaient d'autres occasions de
sociabilité.
|
|
|
|
Les années 1960 marquent une transformation de la sociabilité
des francophones de l'Ouest. La solidarité ethnoculturelle se manifeste
beaucoup moins dans le cadre de la paroisse et des fêtes nationales. On
organise plutôt des radiothons et des fêtes à caractère
patrimonial, comme le célèbre
Festival du Voyageur à
Saint-Boniface. Dans les grands centres naissent de nouveaux lieux de rencontre
autour de la culture. À la campagne, les jeunes ont une sociabilité
qui leur est propre. Cependant, à la campagne comme à la ville, les sports sont
peut-être les
activités qui rassemblent le plus grand nombre de gens.
|
|
|
|
|
|