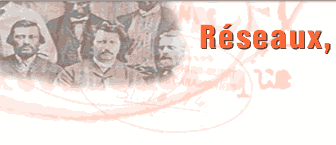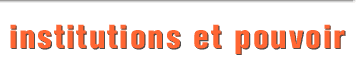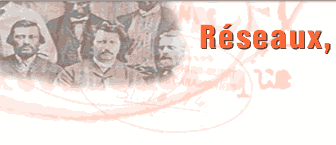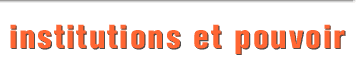|



|
 |
|
Parmi les institutions importantes pour le développement des
communautés francophones,
le mouvement coopératif figure
au premier plan et
le clergé a joué un rôle crucial
dans sa mise sur pied. D’abord lié à l'effort de colonisation, le
mouvement coopératif francophone deviendra particulièrement actif
en Alberta.
|
|
|
|
L’Église était aussi très proche de
la presse
francophone, dont elle se servait pour propager sa vision de la francophonie
de l'Ouest. Plusieurs journaux, cependant, étaient avant tout des
organes
politiques, inféodés au parti conservateur ou au parti libéral,
ce qui ne les empêchait pas d'épouser des causes
« nationales » comme la colonisation. Quelques journaux, peu nombreux,
étaient indépendants.
|
|
|
|
Dès leurs débuts, et quelle que soit leur allégeance,
les journaux francophones ont eu de la difficulté à survivre.
Aujourd'hui encore, les défis de la presse sont grands, comme en fait
foi la disparition du Soleil de Colombie en 1998, après 33 ans
d'existence. Plusieurs tiennent cependant le coup : La Liberté,
au Manitoba, L'eau vive, en Saskatchewan, Le Franco, en Alberta,
L'Aquilon, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, et L'Aurore boréale,
au Yukon, continuent à servir de lien essentiel entre les francophones.
|
|
|
|
À la presse écrite s’ajouta, dans les années 1940,
la radio.
Conçue comme un outil de survie de la francophonie catholique face à
l’influence de la radio anglaise, la radio de langue française devint rapidement
un agent social et culturel, s’occupant notamment d’oeuvres de charité et faisant
la promotion des jeunes talents. Elle était aussi censée raffermir les
liens entre les avant-postes de l'Ouest et la province de Québec.
|
|
|
|
Hier comme aujourd'hui, associations et clubs ont joué un rôle important
au sein de la francophonie de l'Ouest et du Nord-Ouest. En bien des endroits, les
débuts du mouvement associatif furent modestes : on fondait une
société de bienfaisance ou un club local. Puis, les francophones
sentaient le besoin de se regrouper dans des
associations provinciales
ou nationales ayant pour but de défendre et de promouvoir les
intérêts du groupe.
|
|
|
|
Rapidement, les associations provinciales s’impliquèrent dans un grand nombre
de dossiers. Dans les Territoires-du-Nord-Ouest et au Yukon, elles durent trouver des
moyens originaux pour rejoindre de petites communautés dispersées
sur un grand territoire.
|
|
|
|
La vie associative, dans l’Ouest, reste difficile. Parfois, les associations
semblent être otages du gouvernement fédéral. Souvent aussi,
elles éprouvent de la difficulté à mobiliser la population et
ne sont donc pas vraiment représentatives. Il en résulte un leadership
incestueux, dans lequel quelques personnes, au sein d’une communauté,
monopolisent la place publique. Les femmes y sont toutefois de mieux en mieux
représentées.
|
|
|
|
Pour s'épanouir, les francophones de chaque province ont besoin d’un
réseau institutionnel complet. Ils doivent aussi être des joueurs
à part entière dans le secteur économique. En devenant
membres d'organismes provinciaux, régionaux et locaux, et en participant
à diverses activités en français, ils affirment leur
identité.
|
|
|
|
|
|