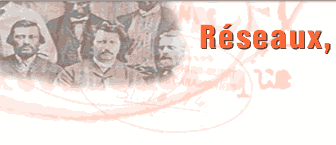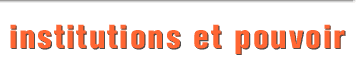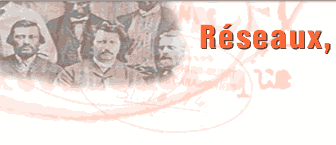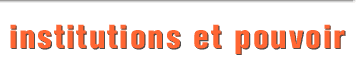|



|
 |
|
L'école constitue un maillon central du réseau institutionnel,
puisqu'elle transmet la langue et la culture qui s'y rattache. C'est pourquoi,
dès 1833, le clergé construisit dans l’Ouest des
collèges classiques afin de former des élites à
même les rangs des cultivateurs. L'entrée au collège
représentait un moment fort dans la vie des garçons. De
jeunes Franco-Européens y devenaient des Canadiens français,
et on y francisait même des anglophones.
|
|
|
|
Les défis de l’éducation française dans l’Ouest
ont toujours été grands. Jusqu'aux années 1960,
les
institutrices travaillaient dans des conditions très difficiles et les
religieuses accaparaient les bonnes écoles, alors que les institutrices
laïques devaient se contenter en général d'écoles de
misère, où les équipements sont vétustes. De
surcroît, il était impossible de se marier si l’on voulait
garder son poste.
|
|
|
|
Mais le plus grand défi pour les enseignantes
fut longtemps de contourner les
lois provinciales anti-catholiques et
anti-françaises passées au tournant du siècle. Elles le
faisaient avec beaucoup d'imagination. Elles avaient l'appui de la majorité
des parents francophones et des associations provinciales, ainsi que de
l'Association interprovinciale. Les élites francophones de
l'Ouest firent beaucoup d'efforts pour contrebalancer l'influence anglaise dans
les écoles en recrutant des institutrices bilingues, en mettant sur pied
des programmes parallèles, en instituant un système parallèle
d'inspection et en créant des
examens annuels de français.
|
|
|
|
Aujourd’hui dans l’Ouest et le Nord-Ouest, les écoles de langue
française sont en concurrence avec les écoles d’immersion,
même si ces dernières sont incapables d’insuffler chez les
jeunes francophones le sens de l’appartenance à leur communauté.
Dans le monde du savoir d’aujourd’hui, l’accès à l'enseignement
supérieur est plus indispensable que jamais au développement de la
communauté francophone de l’Ouest et du Nord-Ouest
|
|
|
|
La revendication des droits a une longue histoire chez les francophones de
l’Ouest. Prêtres, médecins, avocats, journalistes ont dénoncé
haut et fort les injustices dont les francophones étaient victimes et ils ont
mobilisé la population, tout en cherchant des appuis au Québec. À
l'occasion, ils ont pris le sentier de la guerre politique contre le parti responsable
de leurs maux. En Colombie-Britannique, les élèves catholiques ont
même été en grève à la fin des années 1950.
Depuis cette époque, les francophones ont revendiqué devant les tribunaux
leurs droits scolaires et linguistiques, parfois avec succès. L’enjeu est important puisque les droits des francophones se traduisent en
services de la part des gouvernements. Quant aux Métis, ils se
regroupent dans des associations provinciales qui revendiquent leurs droits fonciers
et constitutionnels.
|
|
|
|
Ces batailles reflètent la condition minoritaire des francophones de l'Ouest.
Celle-ci apparaît partout : dans certains districts scolaires
complètement francophones, où, à l'instigation des
inspecteurs provinciaux, les commissaires francophones prohibaient complètement
l'usage du français jusqu'au milieu de la décennie de 1960 ; dans
les institutions d'enseignement supérieur, qui éprouvent aujourd’hui
des difficultés à concurrencer les grandes universités de
langue anglaise ; à Ottawa, où les sénateurs franco-albertains
sont timorés ; à
Maillardville, où les francophones
habitaient les moins bons quartiers; même dans leur forteresse de Saint-Boniface,
où ils furent incapables de faire échouer des projets allant contre leurs
intérêts et dont ils perdirent le contrôle politique.
|
|
|
|
|
|